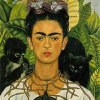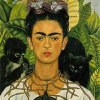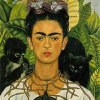|
|
|
|
|
http://www.gerbeaud.com/nature-environnement/sel-route-migration-plante-maritime.php
La végétalisation des autoroutes
Le 15 juin 2014 par Clémentine Desfemmes
Qui ne s'est jamais demandé à quoi servaient ces kilomètres d'arbustes plantés au bord des autoroutes ? La fonction de ces plantations n'est pas seulement esthétique : la végétalisation des autoroutes joue d'autres rôles... Voici donc de quoi prendre la route des vacances avec un regard neuf !
L'autoroute et ses dépendances vertes
L'autoroute, c'est bien plus que des voies de circulation et une bande d'arrêt d'urgence : la société gestionnaire a aussi à aménager et entretenir les "dépendances vertes" de l'autoroute. C'est ainsi que l'on appelle les berges herbacées et arbustives qui sont situées de part et d'autre de l'autoroute.
9225Elles représentent des surfaces non négligeables, dont l'automobiliste n'a que peu conscience : pour 1 km d'autoroute, on compte à peu près 4 hectares de dépendances vertes, ce qui représente en moyenne 10 à 15 mètres de part et d'autre des voies.
Autoroute et ses dépendances vertes
Une végétalisation utile à la biodiversité
La végétalisation des bords d'autoroute assure à la petite faune (petits mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles, insectes...) et à la flore sauvage un lieu de vie intéressant : ces espaces entre l'autoroute et les champs cultivés ou les zones industrielles sont une chance pour certaines espèces qui trouvent là des conditions favorables à leur vie et à leur reproduction.
L'homme n'y intervient que très peu (depuis les années 80, le fauchage régulier concerne uniquement les 2 premiers mètres les plus proches de la voie, et les opérations de taille ou d'élagage ne sont qu'occasionnelles), ce qui laisse le champ relativement libre à la vie sauvage : les abords de l'autoroute sont ainsi, paradoxalement, un véritable réservoir biologique !
Les sociétés d'autoroutes françaises ont d'ailleurs signé en juillet 1993 une Charte Environnement destinée à mieux intégrer les autoroutes dans le paysage, à limiter leurs impacts négatifs (pollution du sol et des eaux, bruit, fragmentation des habitats naturels...) et à favoriser la biodiversité, tant animale que végétale.
D'ailleurs, quand on y réfléchit, les espaces "sauvages" sont, en dehors des réserves naturelles, rares en France : entre les zones agricoles intensives, les exploitations forestières et l'avancée des milieux urbanisés, il reste peu de place pour la flore spontanée ! Il n'est donc pas très étonnant que ce soit le long des axes de circulation que l'on rencontre certaines espèces qui ont été chassées de leur habitat.
Bord d'autoroute enherbé
L'effet corridor : quand les bords d'autoroutes facilitent les migrations d'espèces
Il n'y a pas qu'aux voitures que l'autoroute permet de voyager ! Les espèces sauvages en profitent elles aussi : si l'autoroute en elle-même peut représenter un obstacle (traversée difficile, d'où une fragmentation accrue des habitats naturels, voir notre article sur la Trame Verte et Bleue), les animaux et les plantes peuvent cependant se déplacer facilement le long de l'axe de circulation. Dans cet espace relativement dégagé et continu, les migrations sont facilitées sur de très longues distances : c'est l'effet corridor.
Autoroute - Corridor écologique
Rôles des plantations pour la durabilité des infrastructures
Certes, la prise en compte des enjeux écologiques et environnementaux est importante en matière de choix des plantations.
Mais il ne faut pas oublier que les végétaux sont également là pour pérenniser les aménagements autoroutiers : ils protègent le sol de l'érosion par l'eau (pluie, ruissellement), ils consolident les talus (parfois très hauts : jusqu'à 50 mètres) et empêchent les glissements de terres et autres matériaux de déblais retirés lors du terrassement, et favorisent le drainage des talus grâce à leur système racinaire qui assèche rapidement le sol (notamment en ce qui concerne les arbres et arbustes).
A noter également : les plantations ont aussi eu pour rôle immédiat, au moment de la construction de l'autoroute, de masquer les blessures infligées au paysage : du vert pour camoufler les cicatrices grises (béton) et noires (asphalte), et cicatriser les plaies brunes (sol perturbé, matériaux de déblai) laissées aux abords des voies...
Stabilisation des talus autoroutiers par la végétation
Des plantations utiles à l'automobiliste
Savez-vous que ces plantations sont également là pour faciliter la circulation et la conduite ? A certains endroits, une végétation haute et dense peut protéger efficacement contre le vent (notamment à proximité des panneaux "manche à air", qui annoncent des vents importants susceptibles de provoquer des embardées des véhicules lancés à grande vitesse), ou même contre le bruit : là, ce sont les riverains qui en profitent.
En outre, sachez que les arbustes plantés sur le terre-plein central sont là pour vous éviter d'être ébloui par les phares des véhicules qui arrivent en sens inverse, et qu'ils jouent un rôle de "guidage optique" : grâce à eux, le conducteur anticipe mieux sa trajectoire, et il évalue plus facilement les distances et les vitesses. Ces arbustes "centraux" ont d'ailleurs bien du mérite, car ils ont des conditions de vie difficiles : pollution par les gaz d'échappement et les sels de déneigement, sol et sous-sol de mauvaise qualité, déplacements d'air dus à la circulation, chaleur écrasante en été... Rien d'étonnant à ce que certains semblent un peu rachitiques !
Enfin, les plantations autoroutières participent à l'agrément de l'usager : bien qu'à 130 km/h, l'automobiliste ne distingue pas les détails mais seulement les volumes et les couleurs, la diversité des végétaux plantés le long des autoroutes occupe l'oeil (enfin... surtout celui du passager !).
Autoroute : végétalisation du terre-plein central
Les différents types de végétalisation
Pour schématiser, au bord des autoroutes, la végétation peut prendre 3 visages différents ; dans tous les cas, les choix se portent vers des végétalisations qui ne demandent pas (ou très peu) d'entretien (taille, arrosage, désherbage...).
Engazonnement : les talus et l'ensemble des "dépendances vertes" peuvent être simplement engazonnés, ou du moins habillés d'une pelouse naturelle ;
Plantations de petits arbres, arbustes et vivaces herbacées (horticoles ou sauvages) adaptés aux spécificités de la région (sol, climat, faune et flore), et peu exigeants. Le choix d'essences locales permet de redonner une place à cette flore spontanée et de reconstituer un patrimoine arboré. Les végétaux sont plantés serrés, pour créer rapidement un massif et empêcher les mauvaises herbes de s'installer, et le sol est souvent paillé ou bâché autour des plantations (vous avez sûrement déjà remarqué ces plastiques noirs opaques) pour limiter les besoins en arrosages au moment de la reprise.
Végétation spontanée : ces végétaux ont l'avantage de s'installer rapidement et facilement, mais les espèces invasives y sont hélas souvent très représentées (buddléia, roseau commun exotique, ailante, sumac...) et l'impression globale est souvent celle d'un lieu un peu négligé. On trouve aussi, avec ce type de végétalisation, des plantes exotiques ou cultivées échappées des jardins, ou des plantes de bord de mer, halophiles ou non, implantées loin à l'intérieur des terres (lire : Salage des routes et migration des plantes maritimes).
|
|
|
" L'homme qui fait jaillir l'eau du désert : à la recherche de l'eau profonde"
De Alain GACHET, Ed JC Lattès, 19 € :
Description
Voici l'histoire extraordinaire d'un homme né à Madagascar, aventurier dans l'âme, qui a quitté le monde du pétrole pour partir, dans les espaces les plus hostiles, à la recherche de l'eau - notamment dans les zones de conflits en Afrique et au Moyen-Orient.
Apres avoir été ingénieur chez Elf, chercheur de minerais et de pierre, Alain Gachet a mis au point une nouvelle technique - le Hubble souterrain - qui lui a permis de découvrir d'immenses réserves d'eau dans les zones arides de la planète ; au Turkana au Kenya, au Soudan dans la région du Darfour, en Somalie, en Ethiopie, en Syrie, en Irak, ay Togo.
Une véritable révolution aux enjeux et aux obstacles colossaux : politiques, économiques, militaires.
un nouvel accès à l'eau peut changer tous les équilibres d'une région.
Tous les pouvoirs s'affrontent autour de ces nouvelles ressources.
Et quelles entreprises ou gouvernements vont payer forages et puits pour accéder à l'élément qui peut sauver des millions de vies mais qui ne rapportera rien.
Car l'eau est ce qu'il y a de plus précieux dans ces régions peuplées d'hommes aux revenus insuffisants pour la payer !
Le défi que lance Alain Gachet est titanesque. Les réserves d'eau potable souterraines sont deux cents fois plus importantes que celles qui coulent sur la surface de notre planète.
- -----------------
(bon, c'est de l'eau fossile .. à économiser malgré tout .. )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citation de "sibelius"https://fr.wikipedia.org/wiki/Za%C3%AF_(agriculture)
le ZAI, technique agricole
Wikipédia :
Zaï (agriculture)
Le zaï est une technique culturale traditionnelle originaire d'Afrique de l'Ouest (Mali, Niger, Burkina Faso) aujourd'hui principalement pratiquée par la population du Nord du Burkina Faso (Yatenga).
Elle y est réapparue dans les années 1980 à la suite des périodes de sécheresse connues dans l'ensemble du Sahel après avoir été plus ou moins abandonnée à la suite de périodes d'abondance (1950-1970), de l'éclatement des familles et de la mécanisation de la préparation des nouveaux champs.
Cette technique particulièrement adaptée aux zipellés, surfaces pédologiques encroûtées fortement dégradées, est restée pendant longtemps considérée comme anecdotique par les chercheurs mais rentre aujourd'hui dans les techniques de Conservation des Eaux et des Sols (CES).
En langue Mooré, zai' vient du mot « zaïégré » qui veut dire « se lever tôt et se hâter pour préparer sa terre » car la technique a l'inconvénient de nécessiter 300 heures de travail (pénible) à l'hectare.
Sommaire
Description
Le zaï est une forme particulière de culture en poquet permettant de concentrer l'eau et la fumure (1 à 3 t/ha) dans des microbassins (30 à 40 cm de diamètre, 10 à 15 cm de profondeur) creusés à la daba (pioche à manche court) en quinconce tous les 80 cm où les graines seront semées (une douzaine de graines de sorgho sur les terrains lourds, ou du mil dans les terres sableuses ou gravillonnaires).
La terre retirée du trou est déposée en croissant en aval des trous afin de limiter l'érosion et piéger dans les poquets les sables, limons et matières organiques transportés par le vent.
La surface de sol qui n'est pas travaillée autour des trous sert d'impluvium, et permet donc d'augmenter la quantité d'eau retenue dans les poquets.
Les matières organiques déposées dans chaque microbassin avant la période des pluies attirent les termites du genre Trinervitermes qui creusent des galeries jusqu'à la surface ; ces structures biogéniques tapissées de fèces riches en minéraux permettent l'infiltration de l'eau et la formation de poches d'eau en profondeur, à l'abri de l'évaporation rapide, qui sont exploitées par les racines entre deux pluies.
On recouvre le poquet d'un peu de terre afin que les matières organiques ne soient pas emportées par le ruissellement dès les premières pluies importantes.
L'apport de matière organique (compost ou engrais) et l’utilisation de variétés adaptées de céréales permet de multiplier les rendements par 1001. Une récolte peut atteindre de 400 à 1 000 kg de céréales et autant de paille en fonction des pluies même sur une terre très pauvre.
Zaï agro-forestier
On peut utiliser la même technique pour semer des graines d'arbres ou d'arbustes. Le zaï peut être amélioré par une technique de cordon pierreux améliorant la lutte contre le ruissellement.
Rôle
Le zaï permet de répondre aux six règles importantes dans cette région pour restaurer la productivité agricole des terres :
maîtriser le ruissellement et l'érosion, pour éviter que les fertilisants soient entraînés par les eaux;
restaurer la macroporosité et l'enracinement profond des cultures (travail profond) ;
stabiliser les macropores en enfouissant des matières organiques, de la chaux ou du gypse;
revitaliser la couche superficielle du sol par l'apport de 3 à 10 t/ha de fumier ou compost fermenté ;
rétablir un pH supérieur à 5 pour supprimer les toxicités aluminiques, manganiques, etc. ;
corriger les carences du sol, ou plutôt, fournir aux cultures les compléments minéraux indispensables pour une production optimale de biomasse.
Références
↑ Cirad : Intensification écologique - Consolidation des connaissances et des références sur la réhabilitation des sols dégradés dans la zone sahélienne sèche avec la technique du zaï mécanisé [archive]
Le zaï, une technique traditionnelle africaine de réhabilitation des terres dégradées de la région soudano-sahélienne (Burkina Faso) - E. ROOSE 1, V. KABORE 1, C. GUENAT 2 - 1. ORSTOM, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex 1, France - 2. Laboratoire de Pédologie, 1ATE, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse
Voir aussi :
Articles connexes :
Demi-lune
Yacouba Sawadogo
|
|
|
La demi-lune est une technique agricole visant à déblayer la terre de bassins de quelques mètres, pour former des monticules en formes demi-lunes. Elle est utilisée pour concentrer les précipitations, réduire le ruissellement et pour cultiver sur des terres encroûtées.
Elle est ainsi surtout employée dans les terrains ayant une inclination et ayant un climat aride ou semi-aride.
Malgré ses ressemblances, elle diffère de la technique du zaï.
|
|
|
Yacouba Sawadogo est un paysan né au Burkina Faso, dans la région semi-désertique du Sahel. Après avoir été commerçant, il repart dans la région de Yatenga, au village de Gourga, au début des années 1980, où il décide de stopper l'avancée du désert.
Il adapte et améliore une méthode ancestrale de culture, le zaï. Malgré le scepticisme des habitants de la région, il persiste et des années plus tard une forêt d’une quinzaine d’hectares fait rempart à l'avancée du désert. Les habitants qui avaient fui sont revenus cultiver leurs champs.
Les résultats qu'il obtient font des émules et les méthodes d'agriculture qu'il dispense lors des jours de marché se développent.
Deux fois par an lors des biennales "Les journées du Marché" qu'il organise sur son terrain proche du village de Gourga, il transmet ses techniques, principalement les trous Zaï.
Des centaines de fermiers viennent des environs et des échanges de graines et techniques sont effectués.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Fondé par Jean-Baptiste Chavannes, il y a 40 ans, le Mouvement Paysan Papaye fédère aujourd’hui plus de 60 000 paysans formés à l’agro-écologie, à la gestion des ressources en eau, à des techniques d’élevage innovantes… Dans un seul but : redonner aux paysans leur fierté, et assurer la sécurité alimentaire d’un pays qui importe 60% de son alimentation. Un reportage réalisé par François Porcheron."
|
|
|
Citation de "sepulveda""Fondé par Jean-Baptiste Chavannes, il y a 40 ans, le Mouvement Paysan Papaye fédère aujourd’hui plus de 60 000 paysans formés à l’agro-écologie, à la gestion des ressources en eau, à des techniques d’élevage innovantes… Dans un seul but : redonner aux paysans leur fierté, et assurer la sécurité alimentaire d’un pays qui importe 60% de son alimentation. Un reportage réalisé par François Porcheron."
http://www.rfi.fr/emission/20151101-1-haiti-combat-mouvement-paysan-papaye
un très beau reportage.
à écouter.
|
|
|
Citation de "sepulveda"Citation de "sepulveda""Fondé par Jean-Baptiste Chavannes, il y a 40 ans, le Mouvement Paysan Papaye fédère aujourd’hui plus de 60 000 paysans formés à l’agro-écologie, à la gestion des ressources en eau, à des techniques d’élevage innovantes… Dans un seul but : redonner aux paysans leur fierté, et assurer la sécurité alimentaire d’un pays qui importe 60% de son alimentation. Un reportage réalisé par François Porcheron."
http://www.rfi.fr/emission/20151101-1-haiti-combat-mouvement-paysan-papaye
un très beau reportage.
à écouter.
http://www.mpphaiti.org/
|
|
|
|